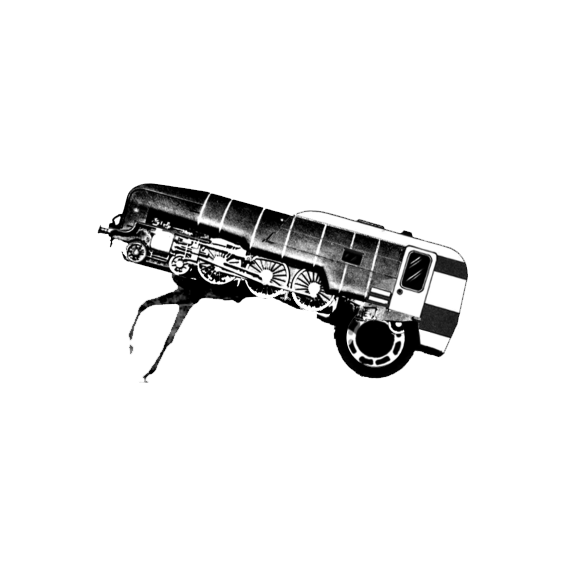menu

BIDONVILLE
DE QUI ES-TU LE PROBLÈME ?
DE QUOI ES-TU LA SOLUTION ?
Numéro 5
Ce pourrait être la forme légère de la ville, mais le bidonville dans son devenir est « dur ». La légèreté n'est qu'une étape de son développement, un moment nécessaire. Là encore, la distinction ou la division par les mots « campements », « bidonvilles », « favelas », « spontanés », si pratique pour écarter du discours telle ou telle forme, est dommageable à la compréhension. Chacun de ces termes doit plutôt être entendu comme un moment du chantier « soft » et permanent vers la « pétrification » de ces espaces, leur « normalisation » (même s'ils inventent des règles et normes non reconnues), leur devenir ville, mais surtout comme les étapes d'un cheminement qui mène ses acteurs du Logement à l'habitat. C'est dans la colonisation que le terme « bidonville » naît et c'est à son prisme, que notre rapport et, plus particulièrement, le rapport de l'État à ce type d'espace doit être entrevu en Algérie comme en France.
DROIT À HABITER CONTRE DROIT AU LOGEMENT
L'abri, qu'il soit solide et permanent, en dur ou non, mobile ou non, précaire ou protégé et garanti, semble bien être un invariant anthropologique. Le lieu de l'habitat est culturellement (en particulier quand on en est propriétaire) entendu comme la marque et la forme de l'indépendance. Son caractère clos et souvent enceint, en particulier dans le cas d'une villa et d'un pavillon, isole, protège et fournit cette quasi-illusion d'indépendance. Cependant, ce lieu est inclus dans une logique complexe de services et de biens communs. Il est raccordé à des réseaux dont il n'est que l'usager pour ne pas dire le locataire (réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone, etc.). Il est, depuis l'après-guerre, quasi systématiquement « pluggé », c'est-à-dire branché ou connecté à ces services, ou tend à l'être. La ville, ou du moins son aménagement entendu au sens large, lui est nécessaire. Pour tous, il est alors nécessaire de se raccorder. Habiter, bien plus qu'une fonction humaine citadine, comme l'avaient défini les partisans de la Charte d'Athènes, est avant tout une manière d'être. Le logement est un local destiné à l'habitation ; l'habitat, lui, comprend le logement, l'ensemble des raccordements aux biens communs et tous les itinéraires du quotidien urbain : les rues, la boulangerie, l'arrêt de bus, le cybercafé ou le marché, tout ce qui permet à l'individu de se situer et d'être « connecté » au monde. Habiter est bien plus nécessaire que se loger. C'est pourquoi la régulation de l'habitat précaire et indécent ne peut faire l'économie d'une réflexion sur les fluides et énergies, sur les services communs, l'équipement public et les réseaux qui rendent possible l'habiter. BIDONVILLE
LEÇON ALGéROISE #1 : POURSUIVRE LA DéCOLONISATION
« Quelques milliers d'Arabes venus s'installer en périphérie pour profiter des opportunités qu'offre la ville. »
C'est à peu près en ces termes qu'au milieu du XIXe siècle le duc d'Aumale décrivait ce qu'il n'avait pas jugé utile de représenter sur son plan de la capitale mobile de l'Algérie : Smala. En ces termes, à peu près, imaginerait-on, aujourd'hui, un ministre évoquer les Platz et terrains autour des villes de France. Mêmes termes, à peu près, pour dire les dizaines de bidonvilles d'Alger dans la langue gouvernementale ; approximative qualification de l'irreprésenté ou précisément du non planifié.
« Quelques milliers... venus s'installer... pour profiter... »
Les plages blanches de la carte n'ont semble-t-il de légendes qu'orales ou médiatiques augmentées de rumeurs et fantasmes qui, en d'autres temps, firent pousser monstres et sorciers dans les terrae incognita e de la carte médiévale.
À Alger, tout comme à Paris ou au Havre, le bien pensant, officiellement encouragé, fait pousser dans le bidonville le monstre social, inadéquat à l'équation du programme de logement gouvernemental. L'habitant, venu d'ailleurs, du Sud, ne serait ici que par choix. Pire, il profiterait de la bienveillance étatique et revendrait à prix d'or le logement décent et désirable qui lui fut offert pour venir se ré-embourber ici, dans ses baraques, terreau de tous les maux : trafic, prostitution, terrorisme.
Le bidonville est à Alger aussi la ville de l'Autre, de l'étranger. Un étranger de l'intérieur venu du Sud pour profiter « des opportunités qu'offre » Alger.
À ce stade, le XIXe siècle se réaffirme en éternel présent, et le problème posé par l'émir Abd el Kader en actualité : « quelle forme de ville pourrait accueillir les hommes du Nord et du Sud ? » La Smala était sa réponse, les Français la détruisirent, nous confisquant un possible futur.
Mais voilà, « nous sommes aussi responsables des enfants que nous n'avons pas eus », alors avançons. BIDONVILLE LEÇON ALGéROISE #2 : LA VILLE NéCESSAIRE
Exemple dans le bidonville d'Aïnadja, une autre forme du développement urbain d'Alger
Nous avions déjà croisé des tentes, bâches bleues tendues sur « l'espace public » fils de la colonisation. Nous les avions croisées, encore, squattant les terrasses de la Casbah dont la valeur patrimoniale méconnue est sans doute l'hospitalité. Nous avions approché de nouveau cette ville croissant sous la poussée de ceux qui manquent de place dans la ville existante, ceux qui dorment à tour de rôle dans des lits. Nous découvrions la ville qui bouge, la ville en mouvement. C'est la ville marginale, traitée avec guère plus de précautions que le militaire français du XIXe siècle traitait la périphérie de la Smala. Ici aussi, aujourd'hui, dans la capitale actuelle, on identifie souvent les habitants de ses toits de bâches ou de tôles comme des opportunistes, venus de « l'intérieur ». Pourtant à entendre les habitants des bidonvilles algérois la réalité diffère. Les « gens de l'intérieur » comme les nomme la ville officielle s'avèrent venir, pour beaucoup, des quartiers populaires du centre d'Alger : Bab el Oued, St Eugène, etc., et dans toutes les bouches, la même histoire se répète. « Je vivais chez mes parents, puis nous nous sommes mariés. Il n'y avait pas assez de place chez eux alors on est venu ici construire une baraque ».
« Nous aussi on a le droit à Alger ! »
Les quartiers du centre d'Alger sont surpeuplés au point que les adolescents attendent souvent dehors une bonne partie de la nuit leur tour pour dormir dans la maison maternelle. « Quelques milliers d'Arabes viennent ici profiter des opportunités qu'offre la ville...(?) » Disons surtout que nous avons rencontré des personnes, revendiquant leur droit à Alger, désignant d'un doigt rageur les immeubles vacants qui entourent leur bidonville. À visiter ces lieux, rencontrer leurs habitants, une tout autre image apparaît, auto-organisation, débrouille et... « ceux de l'intérieur ? Il y a de tout parmi nous, il y a même des fonctionnaires, des policiers ». Ici c'est donc bien l'habitat qui stigmatise et vous désigne comme l'Autre. « Anomalie » répond l'autorité. « Nous aussi on a le droit à Alger ! » répond à son tour notre guide... Comme un programme à la ville nécessaire. BIDONVILLE LEÇON ALGéROISE #3 : LIBéRER L'HISTOIRE
Petite histoire d'une amnésie urbaine. Quand on envoyait prêtres, urbanistes et architectes français dire ailleurs : « le bidonville n'est pas votre problème, mais votre solution »
L'histoire se passe à Rio ou à Alger. Ou plus précisément dans leurs très proches périphéries et vides urbains où des populations pauvres ont élu domicile construisant leurs baraques de ce qu'elles trouvaient. L'histoire oubliée se déroule en ces lieux que la langue officielle vouait déjà à la résorption, y envoyant ses docteurs de l'âme et de la ville. Cette histoire a cinquante ans ou plus, mais la mémoire institutionnelle semble l'avoir effacée à croire que les fourmillements d'experts aux portes des cabinets de ministres, de maires ou de préfets ne parviennent à y apporter les miettes de connaissances salutaires à la colonie.
Jusqu'à présent, pas de solution, donc destruction. Non pour régler le problème, mais bien pour que celui-ci soit réputé insoluble. Laisser faire doit être bien insupportable aux faiseurs de ville pour qu'ils préfèrent le problème à la solution à moins qu'il ne s'agisse de la peur de ce que leurs bouches en chorale appellent « non droit », mais qui n'est en définitive que la recherche et l'invention de solutions sans eux.
Aujourd'hui repris des mains du ministère de l'Intérieur par celui du Logement, le « problème » ou « dossier » change de nom et par conséquent de solution : il ne s'agit plus désormais de « campements à démanteler », mais de « bidonvilles à résorber ».
En ces temps donc où le vocabulaire mafieux et policier fait place à celui de la thérapie, peut-être serait-il nécessaire d'observer ou simplement de se souvenir de ce que d'autres initièrent en leur temps et même, de poursuivre ce travail. Exemple du CIAM d'Alger
Ce ne sont pas de doux rêveurs ou de tendres utopistes qui ici nous éclairent, mais des représentants du mouvement moderne en architecture et en urbanisme. De ces professionnels de la ville qui donnèrent, et ne nous mentons pas, donnent encore le la de l'aménagement urbain.
C'était à Alger, dans cette Algérie où on expérimentait la « politique territoriale » et autre « agence du plan » sur les populations indigènes avant, une fois au point, de les appliquer en métropole. C'était dans cette Algérie où on expérimentait aussi des solutions de logement de masse et à bas prix pour la population « musulmane ». C'était dans cette Algérie où résonnaient déjà les termes de « résorption des bidonvilles » par grandeur d'âme pour certains ou pour garantir la déjà fragile paix civile pour d'autres, que le CIAM d'Alger a produit une analyse des bidonvilles à hauteur d'hommes ! Ils élaborent une étude complète, tant urbaine, qu'architecturale et sociale d'un bidonville d'Alger qui sera présentée lors d'un des congrès du CIAM.
Dans le style graphique propre aux architectes du mouvement, ils présentent, légendés et cotés, plans, coupes, façades et détails d'aménagements intérieurs et extérieurs. Des textes accompagnent ces documents et décrivent les usages des espaces et leurs interactions. Considérant finalement que la forme du bidonville est la réponse juste aux différents besoins des habitants, ils en concluent que la seule qualité manquant à cet espace est celle des matériaux qui le composent. Ainsi, à ce « détail » près les architectes de conclure que le bidonville constitue une solution urbaine architecturale et sociale convenable, si ce n'est souhaitable. Alors faut-il outiller le politique ?
Autant dire, et pour faire court, outiller l'état quand, les mécanismes de celui-ci ont si commodément organisé la cécité, voire l'ignorance, de solutions possibles à cette hauteur d'homme qui ne lui sied guère !
Faut-il croire que les outils, les savoirs, auparavant inventés, que nous exhumons à peu de frais, et que d'autres font mine d'inventer soient désirables ou simplement dignes d'intérêt quand le ministère du Logement confie le programme de résorption des bidonvilles aux bons soins de la SONACOTRA (actuelle ADOMA), spécialiste historique de la gestion et du contrôle des étrangers ? BIDONVILLE LEÇON ALGéROISE #4 : LIBéRER LES MOTS POUR LIBéRER LA VILLE
La colonisation par le verbe
Nous réitérons : les grilles et traits du plan inventés au XVIIIe siècle incarcèrent le futur de nos espaces et de nos villes. Cependant, la ville se dit, se représente, se pense et finalement se fait aussi par les mots. Ces mots qui diagnostiquent le « problème ville » ou le traitent. Les mots de la ville semblent aujourd'hui viser la même hégémonie que ses modes de représentation graphiques (maquette, plan, imagerie 3D).
Les villes du monde se planifient aussi sur la base d'un arsenal littéraire propagé par l'économie comme par les colonisations. Difficile aujourd'hui de se libérer ou d'échapper à un hit-parade de ritournelles urbanistiques : métropolisation, densification, ville durable... D'autant que l'on est condamné à penser depuis les espaces des colons où limites et erreurs originelles naquirent. Là encore, l'issue désirable ne peut se trouver sans interroger l'histoire de ces mots, leur amniotique contexte, sans les miner et les intranquilliser.
Nous le disions, c'est à Alger qu'on apprit à faire Paris en détruisant les tissus complexes, mais aussi en éliminant les mots permettant de les penser.
La France apprit à faire la ville en détruisant et cadastrant Alger. Les premières saignées dans le tissu complexe de la Casbah annoncent l'urbanisme contre insurrectionnel de Paris. À détruire Alger, on invente les manières et les mots pour qu'une ville se combatte elle-même. Les mots, car tout autant que les coups de pelles et de pioches ou les dynamitages, ils ont anéanti la ville. Les mots « rue », « place », « espace public », « privé » ont fait bien davantage que de remplacer les « Derb », « Znika », « Hawma ». Ils les ont détruits et interdisent durablement leur ré-émergence.
La France apprit à faire Paris, Lyon, Marseille en détruisant Alger et forgeant là les nouveaux mots de l'urbanisme qu'elle laissera après la révolution algérienne. Ces mots devenus hégémoniques ont contaminé une planète entière ou presque. C'est dans le carcan de ces mots que se pense la ville alors comment s'étonner que, sur des mots de guerre, elle ne puisse être que machine excluante et hostile. Peut-être alors pour penser la ville autre que globale, convient-il d'en décoloniser les représentations et les mots ? La penser depuis le langage populaire, celui de ceux qui la vivent et en finissent souvent exclus.
Des mots qui acceptent de dire l'urbanité du bidonville
L'Algérie est un espace plurilingue où coexistent l'arabe classique, l'arabe dialectal (et ses parlers régionaux), les langues berbères et le français.
Les termes suivants de « Khelwi », « Hawma », « Houma », « Orma » et « Fawdawi » ne figurent pas au dictionnaire d'arabe littéral. Ils n'en sont pas moins essentiels pour traduire l'expérience qui consiste à habiter une ville comme Alger. Et, absents des préoccupations des « faiseurs de villes » (architectes, urbanistes, etc.) qui plaquent sur cet espace des projets indifférents à leurs habitants. Khelwi, Hawma, Houma, Orma et Fawdawi sont autant de mots clés ouvrant sur une autre lecture d'Alger.
Ce sont ces mots qu'avec nos camarades algériens, étudiants et chômeurs, nous avons tentés de définir puis d'interroger, faisant passer les espaces de la ville et en particulier les espaces autoconstruits et non planifiés au tamis de ceux-ci. Et, ce n'est peut-être pas si étrange que nous ayons retrouvé dans le tissu des bidonvilles une part du tissu ancien de la Casbah que l'armée française (ses ingénieurs du génie, ses architectes, cartographes et urbanistes) détruisit. En particulier, cette lente progression de ce que nous appelons « espace public » à ce, qu'encore, nous appelons « espace privé ». À lire ainsi le bidonville réapparaissaient les derb, znirha et autres... expressions qui ont, dans la culture du peuple, résisté à la colonisation de l'espace et de l'esprit.
Il convient de poursuivre la décolonisation de la langue comme le préconisait Kateb Yacine pour entendre des réalités neuves et dépoussiérées de leur gangue de passé.
Khelwi
Terme dérivé du vocable « Khalwa » désignant la retraite des adeptes du soufisme (forme mystique de l'islam sunnite). également lié à « Khla » (le vide). Dans son sens profane, khelwi désigne un sentiment de bien-être et de plénitude passager, fréquemment associé au silence et à une sensation de complétude. Dans le langage commun, khelwi signifie aussi « super ! »
Fawdawi
Dérivé de l'expression « al bina al fadawi » utilisée dans l'administration algérienne pour désigner un habitat construit hors des normes légales et qui se traduit généralement par « habitat anarchique ». Cette expression sera reprise par les habitants de ces espaces pour s'autodésigner et revendiquer une place dans la ville. Plus largement, fawdawi désigne le désordre, le chaos, l'anarchie, ou ce qui échappe au contrôle.
Hama
Notion désignant les relations sociales établies entre les habitants d'un même quartier et, par extension, les différents quartiers de la ville. La hawma est un espace protégé, mais sous contrôle, régi par un code de comportements spécifiques. Espace dont les limites géographiques sont mouvantes, souvent tourné vers d'une mosquée et d'une école, mais principalement incarné par les individus qui le composent.
Derb
Sorte d'impasse, unité fondamentale du voisinage protégée et « intimisée » par des décrochements et des angles morts. Le derb s'intégrait à l'unité spatiale plus vaste, qu'est la hawma.
Anika
Impasse, plus intime que la précédente, commune à quelques familles seulement. L'unité spatiale se resserre aussi autour d'un espace que nous pourrions appelé semi-privé.
Houma
Concept exprimant le distingo entre ce qui appartient au même groupe et ce qui est situé hors de ses limites. Désigne l'endehors et communément, « les autres », se traduisant par « eux ».
Orma
Notion d'intimité et de territoire privé, s'appliquant par extension à l'espace du dedans, de la vie intérieure et de l'intime. BIDONVILLE LEÇON ALGéROISE #5 : LE DEVENIR VILLE DU BIDONVILLE LA CASBAH D'ALGER : UN BIDONVILLE CLASSé À L'UNESCO
Pour qui a rêvé « Alger la blanche » sur les chansons de Lili Boniche, il peut être déroutant à la visite de la Casbah et de ses abords de découvrir des toits-terrasses « squattés » de tentes et de paraboles, d'hasardeux agrandissements en matériaux contemporains et synthétiques, ou de voir des piliers ottomans et leurs pleins cintres « zigouillés » au profit de quelques poutres métalliques libérant l'espace au sol pour y garer davantage de voitures ou simplifier le stockage.
C'est oublier qu'on y vit à 50 000 ; qu'à la Casbah, les pauvres ont encore droit de cité. Et que la Casbah, loin d'être figée dans un passé vertueux, évolue et continue d'accueillir de nouveaux habitants même si, « pour y dormir, faut se pousser » et faire de la place au milieu des divers palais, hammams, mosquées et souks, dont la forme urbaine représente le témoignage d'une stratification de plusieurs tendances dans un système complexe et original qui s'est adapté, avec une remarquable souplesse, à un site fortement accidenté.
En décembre 2013 on célébrait le 21e anniversaire du classement de la Casbah d'Alger, dans la liste du patrimoine mondial de l'Unesco qui identifie des menaces à l'intégrité du site liées à là « sur-densification » et à des « interventions non contrôlées ». D'autres risques proviennent des séismes et des incendies, ainsi que des glissements de terrain et des inondations.
C'est alors cette dimension immatérielle de l'accueil, imprimant parfois au visage de la Casbah les stigmates du bidonville, que mettent en danger les différents projets de réhabilitation et le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé (PPSMVSS), codifié par le décret exécutif n° 324-2003 et encore en préparation.
Désormais classées, les pierres de la Casbah doivent être conservées, restaurées. Reste à définir les moyens d'y parvenir. Restauration de ce qui peut l'être ? Reconstitution à l'identique de ce qui manquerait au tableau original ? Les différentes écoles du « bien restauré » ont de quoi s'affronter. Le modèle espagnol préconise, à l'instar de la réhabilitation (réputée réussie) de la Medina de Tolède, de conserver de la Casbah ce qui peut l'être, mais surtout d'assumer nos incapacités, y compris techniques, à restaurer certains bâtiments sans les dénaturer profondément. Ainsi, on préférera parfois la destruction à un « acharnement patrimonialistique », transformant leur emprise au sol en espace public, places, jardins, belvédères. La réhabilitation devient l'occasion d'aérer en quelque sorte le tissu. Une partie du patrimoine bâti étant confié aux soins de propriétaires privés disposant de l'envie et des ressources pour restaurer (dans les règles) et entretenir les abords des bâtiments.
Cette solution a pour elle le bon sens et la compréhension d'un quartier et de ses acteurs comme une sorte d'écosystème. Elle implique cependant d'évincer l'écosystème existant, incapable d'oeuvrer à la patrimonialisation (en l'espèce, les habitants pauvres) au profit d'un autre possédant moyens et culture. Elle implique d'autre part une transformation radicale du tissu et, par là, de ce qui a malgré tout résisté au temps et aux multiples interventions urbaines, c'est à dire ce complexe dialogue entre (les mots précis manquent à la langue française) espace public et espace privé. Exit donc « derb », « znirha », etc. composantes d'un système spatial encore opérant. La patrimonialisation du bâti préconisée dé-patrimonialise l'urbanité présente. Exit aussi, les tentes sur les toits, les agrandissements nécessaires à l'activité ou la famille. Exit en somme une valeur patrimoniale immatérielle de la Casbah : l'accueil ! C'est ailleurs que cette dimension, inconsidérée par le plan de sauvegarde, se réorganise recomposant, l'urbanité de la Casbah dans les bidonvilles d'Alger. LEÇON STéPHANAISE #1 : LORSQUE L'EXISTANT NE SE VOIT PAS
Derrière le mur peinturluré de la bretelle d'autoroute reliant Rouen au reste du monde, au pied d'une centrale électrique se trouvent des baraques en dur ou presque, construites de 1950 à aujourd'hui, entre les pylônes des lignes à haute tension. Portes, fenêtres à double vitrage, boîtes aux lettres, balançoire dans le jardin, au fil du temps, 28 petits pavillons se sont consolidés et sont devenus lieux de vie - et pour certains, de travail - de nombreuses familles.
Jean, 43 ans, vit dans cette rue depuis 16 ans.
« À l'époque, j'ai acheté ça une bouchée de pain, c'était une ruine quand je suis arrivé, mais avec tous les travaux que j'ai faits dedans, elle vaudrait 30 000 euros maintenant. » Surpris de me croiser dans cette rue où personne ne passe, il m'invite à boire un café dans cette maison où il vit seul et qu'il est fier d'avoir entièrement refaite à neuf, de la plomberie de la salle de bain aux fenêtres à double vitrage qui le protègent du bruit incessant des voitures qui s'engagent sur l'A13 et que le mur dressé là - pour les soustraire au bruit autant qu'aux regards - ne suffit pas à atténuer. Il voudrait refaire sa façade, mais sa priorité est avant tout d'acheter une voiture pour aller travailler comme menuisier avec ses frères, qui vivent dans la même rue. Et pour aller à Darnétal, au pôle emploi où il ne peut plus se rendre en bus depuis que les bureaux ont été déplacés.
S'il loue le terrain comme parcelle-potager 500€ par an, sa maison en revanche est à lui depuis qu'il l'a achetée à celui qui l'avait construite et y vivait avant lui. Officellement il n'est pourtant ni locataire, puisqu'il ne peut légalement vivre sur son terrain, ni propriétaire puisque cet habitat n'a pas le droit d'exister.
« On a essayé plusieurs fois. On a fait des pétitions. On est allé les voir pour avoir au moins une belle route, un peu de bitume, des lumières dans la rue, mais ils ne veulent pas, et le propriétaire s'y oppose aussi. » En cette absence de statut et d'une quelconque reconnaissance, malgré les requêtes des habitants et l'existence de ce quartier depuis plus de 60 ans, l'électricité reste le seul réseau auquel l'accès leur a été concédé.
« Mais c'est un quartier très tranquille ici, on y vit bien. »
Il connaît tout le monde. Depuis qu'il est là, presque personne n'est parti ni arrivé. Un certain esprit de « communauté » s'est installé. Lui est sicilien, né en France, il confirmera qu'encore aujourd'hui, beaucoup des habitants sont d'origine portugaise, arrivés au milieu du siècle dernier, à l'époque où la main-d'oeuvre étrangère était bienvenue dans les villes industrielles. Les enfants récupèrent la maison des parents ou en achètent une dans la rue, à un voisin.
« S'ils partent, ils doivent abandonner leur maison, et ça, personne ne le souhaite. Le propriétaire a donné un peu d'argent aux gens qui ont abandonné la maison au bout de la rue, mais vraiment rien »
Ces maisons n'ont d'existence que pour ceux qui les ont bâties, ou les habitent. Il n'existe pas de termes pour définir ces modes d'habiter, pour conférer un « statut » à ces habitants, le leur n'étant pour l'heure défini qu'en négatif : « sans droit ni titre. »
« Ce sont des maisons qui se sont construites comme ça. C'était des jardins et petit à petit ils ont construit des baraques et aujourd'hui des maisons. Enfin, ... ce sont des gens sans droit ni titre »
« Sans droit ni titre », au regard seulement de la notion de propriété privée. Qu'en est-il du droit de vivre, d'avoir un toit sur la tête, et même le luxe d'un petit jardin, d'un atelier ou d'un garage ? Qu'en est-il de ce droit d'être pris en considération par la commune dans laquelle on vit depuis 60 ans ? Du droit à habiter ?
Pour le PLU, ce quartier est « une sorte de lotissement défectueux », dont on n'est pas sûr de pouvoir affirmer qu'il s'agisse d'habitat. La solution proposée par les urbanistes en charge du dossier est si récurrente qu'elle surprend à peine : expulser les occupants « sans droit ni titre », donc sans difficulté ni scrupule, faire place nette et faire intervenir un aménageur - aujourd'hui seul maître habilité à faire de la ville. Ce dernier pourra construire et vendre en lieu et place de ce quartier d'habitation, un autre quartier d'habitation, le bon cette fois, beau et homogène, pour accueillir un jeune couple de cadres embauchés dans une des entreprises du technopôle du Madrillet. Puisque finalement, pour poursuivre son rêve de Silicon Valley normande, la ville doit pouvoir loger ses ingénieurs.
D'autres espaces, présents mais invisibles aux yeux de la ville, ponctuent le territoire. Cet ancien coron ouvrier par exemple : la Cité Maurice Blot, à l'abandon depuis vingt ans. Les derniers habitants regardent partir à la dérive au large d'une ville qui était autrefois la leur, et dont l'état de délabrement est conditionné par cette peur du squat qui pousse le propriétaire a ôter portes et fenêtres aux maisons qui n'ont plus de forme qu'approximative.
De l'autre côté, à l'orée de la forêt, une autre rue - prolongée – à laquelle on n'a pas jugé utile de donner un nom, d'autres parcelles - potagers transformées spontanément en lieux de vie, des caravanes, des camping-cars aussi, sur un carré bitumé qui fait office d'aire d'accueil improvisée.
Si le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est moins bavard sur le devenir de ces habitats, on l'imagine tout de même mal intégrer l'actuel usage de ces terrains et leurs occupants à cette zone - « destinée à constituer le principal territoire de développement urbain de la commune à moyen et long termes. »
Si le PLU doit permettre, entre autres, aux villes de répondre par un urbanisme contrôlé aux « besoins émanant des situations locales », à quel chapitre des 129 pages de réglementation urbaine voit-on apparaître ces situations, aussi spontanées, précaires et informelles soient-elles, autrement que dans la perspective d'en faire table rase ? L'enjeu ne serait-il pas plutôt la recherche d'articulation de la ville officielle avec ces espaces qui ont déjà une vie, plutôt que de les raser en réponse à un insatiable besoin de logements neufs, de rues fraîchement bitumées, et de statistiques vantant la hausse du niveau de vie dans les quartiers « les plus défavorisés » ? Pourquoi ne pas admettre alors la spontanéité comme moyen juste, légitime et non violent de faire de la ville? CE N'EST PAS LE BIDONVILLE QUI INQUIÈTE LA RéPUBLIQUE, MAIS SA SOLUTION
Le 16 juillet 2013, à six heures, les habitants du bidonville du quartier de l'Eure ont été expulsés, en dépit des propositions d'accompagnement global des familles rroms, avancées par plusieurs associations travaillant avec les habitants, dont Echelle inconnue. Mardi 16 juillet 2013, ce que nous pensions pouvoir éviter est arrivé : célébration d'une nouvelle noce du bulldozer et de l'uniforme, siège du bidonville, « extraction » des familles, soit quatre-vingts personnes (dont 45 enfants) jetées encore un peu plus à la rue après le passage des bulldozers sur leurs habitations.
Pourtant, depuis plusieurs mois, à l'invitation du collectif de soutien, et des habitants eux-mêmes, nous travaillons avec les habitants du bidonville, réalisons, photos, vidéos, enregistrements. Outillons aussi le nomadisme que la République impose à ces populations en réalisant des équipements sanitaires nomades. Comme d'autres en France, nous nous attachons à aménager collectivement l'enfer.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2013, nous soumettions à la sous-préfecture du Havre un projet alternatif d'accompagnement des familles rroms vivant sur le bidonville du quartier de l'Eure ; projet plus économe en argent public que son simple anéantissement par bulldozers.
Le récépissé venait à peine d'être glissé sous notre porte que les uniformes se précipitaient pour ceinturer le bidonville situé à l'angle des rues du Général de La Salle et du général Hoche dans le quartier de l'Eure au Havre.
Ce projet soutenu par la Fondation Abbé Pierre et le Conseil Général, Cinecittà, la cité Rrom , prévoyait l'établissement d'un permis précaire d'un an (voir l'article consacré à Cinecittà p16). Un an, pour sortir du bidonville par le bidonville. Un an pour mettre en veille la politique de nomadisation forcée et pour mener à bien un projet cinématographique non pour les Rroms, mais avec eux, sans pour autant les cantonner au statut de figurants exotiques que l'industrie cinématographique semble leur réserver.
En collaboration avec le Conseil général qui devait, suite à notre interpellation, organiser une réunion avec les équipes chargées de l'accompagnement social, nous proposons de poursuivre le travail de « raccordement au monde » : rencontre avec les équipes de Médecins du Monde, prise de contact avec des entreprises privées locales, invention de solutions pour aménager cette urbanité née de la nécessité. La sous-préfecture, ce matin, a répondu : uniformes, siège et expulsion. Déjà au loin se font entendre les chenilles des bulldozers, ces nouveaux tanks de la petite guerre urbaine. Déjà, nous avions eu l'occasion d'entrevoir quelques-unes des solutions préfectorales : recensement des familles sur une table d'administration, rappelant sa sinistre ancêtre coloniale, avec l'aide d'un traducteur visiblement proche des services de police.
Quatre-vingts personnes, familles avec enfants se voyaient délivrer un simple papier écrit en romani les invitant à appeler le 115 !
Est-ce pur hasard que notre courrier semble croiser, si ce n'est déclencher, l'intervention policière ? Nous nous permettons d'en douter. La République a depuis longtemps choisi sa méthode, insensée : inquiéter, insécuriser et entretenir avec soin son syndrome de cécité volontaire.
À ce point qu'il est difficile de ne pas conclure que ce n'est pas tant le bidonville et son indignité qui effraient la République, mais la recherche de solution durable pour des populations, parmi les plus vulnérables, avec lesquelles il faut bien compter.
COÛT DE L'EXPULSION DU 16/07/2013 = 130 000 euros
nsensé d'une république qui a pourtant fait de la calculatrice le la de ses politiques. Trois mois après l'expulsion du Platz , le terrain est toujours là, vide. Un projet de caserne devrait voir le jour d'ici 5 à 10 ans. Ici, à la place des murs d'enceinte tombés, qui entouraient le Platz , ont poussé de grandes grilles vertes, laissant filtrer le regard et empêchant d'y adosser des cabanes. Comme précaution supplémentaire contre le risque que d'autres, motorisés cette fois, puissent un jour s'y installer, de grosses pierres noires ont été déposées tous les mètres, comme précaution supplémentaire. Expulser et maintenir un lieu vide de toute tentative de vie coûtent cher à nos institutions. L'expulsion du bidonville - Diagnostic social, ici réalisé par l'Association Française des Femmes en Difficulté et l'Armée du Salut. 15 000€
- Préparatifs au sein des institutions (réunion de travail en mairie, en préfecture, au conseil général).
10 000€
- Frais de justice (arrêté d'expulsion, recours, temps de travail des juges, avocats, etc.) ?
- Expulsion (présence de 50 CRS à 97 euros/jour et de camions, locations de pelleteuses à 870 euros/jour). 7 500€
- Nettoyage du terrain ?
- Propositions d'hébergement (20 places pendant 3 mois, ainsi que 20 repas par jour. Les 87 personnes du bidonville se sont relayées toutes les semaines) à l'Armée du Salut, pris en charge par la DIHAL et la DDCS. 65 000€
Soit 97 500€
Maintenir le terrain vierge de toute intrusion :
- Démolition de 280 mètres linéaires de mur en béton (hauteur 2,00 m) à 30 euros/m2, et la mise en benne. 18 800 €
- Pose de 230 mètres linéaires de grille verte (hauteur 2,00m), c'est-à-dire 90 plaques à 60 euros l'une. 5 400 €
- Pose d'environ 70 pierres d'une tonne chacune (100 euros la tonne). 7 000 €
Soit 31 200€
L'abri, qu'il soit solide et permanent, en dur ou non, mobile ou non, précaire ou protégé et garanti, semble bien être un invariant anthropologique. Le lieu de l'habitat est culturellement (en particulier quand on en est propriétaire) entendu comme la marque et la forme de l'indépendance. Son caractère clos et souvent enceint, en particulier dans le cas d'une villa et d'un pavillon, isole, protège et fournit cette quasi-illusion d'indépendance. Cependant, ce lieu est inclus dans une logique complexe de services et de biens communs. Il est raccordé à des réseaux dont il n'est que l'usager pour ne pas dire le locataire (réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone, etc.). Il est, depuis l'après-guerre, quasi systématiquement « pluggé », c'est-à-dire branché ou connecté à ces services, ou tend à l'être. La ville, ou du moins son aménagement entendu au sens large, lui est nécessaire. Pour tous, il est alors nécessaire de se raccorder. Habiter, bien plus qu'une fonction humaine citadine, comme l'avaient défini les partisans de la Charte d'Athènes, est avant tout une manière d'être. Le logement est un local destiné à l'habitation ; l'habitat, lui, comprend le logement, l'ensemble des raccordements aux biens communs et tous les itinéraires du quotidien urbain : les rues, la boulangerie, l'arrêt de bus, le cybercafé ou le marché, tout ce qui permet à l'individu de se situer et d'être « connecté » au monde. Habiter est bien plus nécessaire que se loger. C'est pourquoi la régulation de l'habitat précaire et indécent ne peut faire l'économie d'une réflexion sur les fluides et énergies, sur les services communs, l'équipement public et les réseaux qui rendent possible l'habiter. BIDONVILLE
LEÇON ALGéROISE #1 : POURSUIVRE LA DéCOLONISATION
« Quelques milliers d'Arabes venus s'installer en périphérie pour profiter des opportunités qu'offre la ville. »
C'est à peu près en ces termes qu'au milieu du XIXe siècle le duc d'Aumale décrivait ce qu'il n'avait pas jugé utile de représenter sur son plan de la capitale mobile de l'Algérie : Smala. En ces termes, à peu près, imaginerait-on, aujourd'hui, un ministre évoquer les Platz et terrains autour des villes de France. Mêmes termes, à peu près, pour dire les dizaines de bidonvilles d'Alger dans la langue gouvernementale ; approximative qualification de l'irreprésenté ou précisément du non planifié.
« Quelques milliers... venus s'installer... pour profiter... »
Les plages blanches de la carte n'ont semble-t-il de légendes qu'orales ou médiatiques augmentées de rumeurs et fantasmes qui, en d'autres temps, firent pousser monstres et sorciers dans les terrae incognita e de la carte médiévale.
À Alger, tout comme à Paris ou au Havre, le bien pensant, officiellement encouragé, fait pousser dans le bidonville le monstre social, inadéquat à l'équation du programme de logement gouvernemental. L'habitant, venu d'ailleurs, du Sud, ne serait ici que par choix. Pire, il profiterait de la bienveillance étatique et revendrait à prix d'or le logement décent et désirable qui lui fut offert pour venir se ré-embourber ici, dans ses baraques, terreau de tous les maux : trafic, prostitution, terrorisme.
Le bidonville est à Alger aussi la ville de l'Autre, de l'étranger. Un étranger de l'intérieur venu du Sud pour profiter « des opportunités qu'offre » Alger.
À ce stade, le XIXe siècle se réaffirme en éternel présent, et le problème posé par l'émir Abd el Kader en actualité : « quelle forme de ville pourrait accueillir les hommes du Nord et du Sud ? » La Smala était sa réponse, les Français la détruisirent, nous confisquant un possible futur.
Mais voilà, « nous sommes aussi responsables des enfants que nous n'avons pas eus », alors avançons. BIDONVILLE LEÇON ALGéROISE #2 : LA VILLE NéCESSAIRE
Exemple dans le bidonville d'Aïnadja, une autre forme du développement urbain d'Alger
Nous avions déjà croisé des tentes, bâches bleues tendues sur « l'espace public » fils de la colonisation. Nous les avions croisées, encore, squattant les terrasses de la Casbah dont la valeur patrimoniale méconnue est sans doute l'hospitalité. Nous avions approché de nouveau cette ville croissant sous la poussée de ceux qui manquent de place dans la ville existante, ceux qui dorment à tour de rôle dans des lits. Nous découvrions la ville qui bouge, la ville en mouvement. C'est la ville marginale, traitée avec guère plus de précautions que le militaire français du XIXe siècle traitait la périphérie de la Smala. Ici aussi, aujourd'hui, dans la capitale actuelle, on identifie souvent les habitants de ses toits de bâches ou de tôles comme des opportunistes, venus de « l'intérieur ». Pourtant à entendre les habitants des bidonvilles algérois la réalité diffère. Les « gens de l'intérieur » comme les nomme la ville officielle s'avèrent venir, pour beaucoup, des quartiers populaires du centre d'Alger : Bab el Oued, St Eugène, etc., et dans toutes les bouches, la même histoire se répète. « Je vivais chez mes parents, puis nous nous sommes mariés. Il n'y avait pas assez de place chez eux alors on est venu ici construire une baraque ».
« Nous aussi on a le droit à Alger ! »
Les quartiers du centre d'Alger sont surpeuplés au point que les adolescents attendent souvent dehors une bonne partie de la nuit leur tour pour dormir dans la maison maternelle. « Quelques milliers d'Arabes viennent ici profiter des opportunités qu'offre la ville...(?) » Disons surtout que nous avons rencontré des personnes, revendiquant leur droit à Alger, désignant d'un doigt rageur les immeubles vacants qui entourent leur bidonville. À visiter ces lieux, rencontrer leurs habitants, une tout autre image apparaît, auto-organisation, débrouille et... « ceux de l'intérieur ? Il y a de tout parmi nous, il y a même des fonctionnaires, des policiers ». Ici c'est donc bien l'habitat qui stigmatise et vous désigne comme l'Autre. « Anomalie » répond l'autorité. « Nous aussi on a le droit à Alger ! » répond à son tour notre guide... Comme un programme à la ville nécessaire. BIDONVILLE LEÇON ALGéROISE #3 : LIBéRER L'HISTOIRE
Petite histoire d'une amnésie urbaine. Quand on envoyait prêtres, urbanistes et architectes français dire ailleurs : « le bidonville n'est pas votre problème, mais votre solution »
L'histoire se passe à Rio ou à Alger. Ou plus précisément dans leurs très proches périphéries et vides urbains où des populations pauvres ont élu domicile construisant leurs baraques de ce qu'elles trouvaient. L'histoire oubliée se déroule en ces lieux que la langue officielle vouait déjà à la résorption, y envoyant ses docteurs de l'âme et de la ville. Cette histoire a cinquante ans ou plus, mais la mémoire institutionnelle semble l'avoir effacée à croire que les fourmillements d'experts aux portes des cabinets de ministres, de maires ou de préfets ne parviennent à y apporter les miettes de connaissances salutaires à la colonie.
Jusqu'à présent, pas de solution, donc destruction. Non pour régler le problème, mais bien pour que celui-ci soit réputé insoluble. Laisser faire doit être bien insupportable aux faiseurs de ville pour qu'ils préfèrent le problème à la solution à moins qu'il ne s'agisse de la peur de ce que leurs bouches en chorale appellent « non droit », mais qui n'est en définitive que la recherche et l'invention de solutions sans eux.
Aujourd'hui repris des mains du ministère de l'Intérieur par celui du Logement, le « problème » ou « dossier » change de nom et par conséquent de solution : il ne s'agit plus désormais de « campements à démanteler », mais de « bidonvilles à résorber ».
En ces temps donc où le vocabulaire mafieux et policier fait place à celui de la thérapie, peut-être serait-il nécessaire d'observer ou simplement de se souvenir de ce que d'autres initièrent en leur temps et même, de poursuivre ce travail. Exemple du CIAM d'Alger
Ce ne sont pas de doux rêveurs ou de tendres utopistes qui ici nous éclairent, mais des représentants du mouvement moderne en architecture et en urbanisme. De ces professionnels de la ville qui donnèrent, et ne nous mentons pas, donnent encore le la de l'aménagement urbain.
C'était à Alger, dans cette Algérie où on expérimentait la « politique territoriale » et autre « agence du plan » sur les populations indigènes avant, une fois au point, de les appliquer en métropole. C'était dans cette Algérie où on expérimentait aussi des solutions de logement de masse et à bas prix pour la population « musulmane ». C'était dans cette Algérie où résonnaient déjà les termes de « résorption des bidonvilles » par grandeur d'âme pour certains ou pour garantir la déjà fragile paix civile pour d'autres, que le CIAM d'Alger a produit une analyse des bidonvilles à hauteur d'hommes ! Ils élaborent une étude complète, tant urbaine, qu'architecturale et sociale d'un bidonville d'Alger qui sera présentée lors d'un des congrès du CIAM.
Dans le style graphique propre aux architectes du mouvement, ils présentent, légendés et cotés, plans, coupes, façades et détails d'aménagements intérieurs et extérieurs. Des textes accompagnent ces documents et décrivent les usages des espaces et leurs interactions. Considérant finalement que la forme du bidonville est la réponse juste aux différents besoins des habitants, ils en concluent que la seule qualité manquant à cet espace est celle des matériaux qui le composent. Ainsi, à ce « détail » près les architectes de conclure que le bidonville constitue une solution urbaine architecturale et sociale convenable, si ce n'est souhaitable. Alors faut-il outiller le politique ?
Autant dire, et pour faire court, outiller l'état quand, les mécanismes de celui-ci ont si commodément organisé la cécité, voire l'ignorance, de solutions possibles à cette hauteur d'homme qui ne lui sied guère !
Faut-il croire que les outils, les savoirs, auparavant inventés, que nous exhumons à peu de frais, et que d'autres font mine d'inventer soient désirables ou simplement dignes d'intérêt quand le ministère du Logement confie le programme de résorption des bidonvilles aux bons soins de la SONACOTRA (actuelle ADOMA), spécialiste historique de la gestion et du contrôle des étrangers ? BIDONVILLE LEÇON ALGéROISE #4 : LIBéRER LES MOTS POUR LIBéRER LA VILLE
La colonisation par le verbe
Les villes du monde se planifient aussi sur la base d'un arsenal littéraire propagé par l'économie comme par les colonisations. Difficile aujourd'hui de se libérer ou d'échapper à un hit-parade de ritournelles urbanistiques : métropolisation, densification, ville durable... D'autant que l'on est condamné à penser depuis les espaces des colons où limites et erreurs originelles naquirent. Là encore, l'issue désirable ne peut se trouver sans interroger l'histoire de ces mots, leur amniotique contexte, sans les miner et les intranquilliser.
Nous le disions, c'est à Alger qu'on apprit à faire Paris en détruisant les tissus complexes, mais aussi en éliminant les mots permettant de les penser.
La France apprit à faire la ville en détruisant et cadastrant Alger. Les premières saignées dans le tissu complexe de la Casbah annoncent l'urbanisme contre insurrectionnel de Paris. À détruire Alger, on invente les manières et les mots pour qu'une ville se combatte elle-même. Les mots, car tout autant que les coups de pelles et de pioches ou les dynamitages, ils ont anéanti la ville. Les mots « rue », « place », « espace public », « privé » ont fait bien davantage que de remplacer les « Derb », « Znika », « Hawma ». Ils les ont détruits et interdisent durablement leur ré-émergence.
La France apprit à faire Paris, Lyon, Marseille en détruisant Alger et forgeant là les nouveaux mots de l'urbanisme qu'elle laissera après la révolution algérienne. Ces mots devenus hégémoniques ont contaminé une planète entière ou presque. C'est dans le carcan de ces mots que se pense la ville alors comment s'étonner que, sur des mots de guerre, elle ne puisse être que machine excluante et hostile. Peut-être alors pour penser la ville autre que globale, convient-il d'en décoloniser les représentations et les mots ? La penser depuis le langage populaire, celui de ceux qui la vivent et en finissent souvent exclus.
Des mots qui acceptent de dire l'urbanité du bidonville
L'Algérie est un espace plurilingue où coexistent l'arabe classique, l'arabe dialectal (et ses parlers régionaux), les langues berbères et le français.
Les termes suivants de « Khelwi », « Hawma », « Houma », « Orma » et « Fawdawi » ne figurent pas au dictionnaire d'arabe littéral. Ils n'en sont pas moins essentiels pour traduire l'expérience qui consiste à habiter une ville comme Alger. Et, absents des préoccupations des « faiseurs de villes » (architectes, urbanistes, etc.) qui plaquent sur cet espace des projets indifférents à leurs habitants. Khelwi, Hawma, Houma, Orma et Fawdawi sont autant de mots clés ouvrant sur une autre lecture d'Alger.
Ce sont ces mots qu'avec nos camarades algériens, étudiants et chômeurs, nous avons tentés de définir puis d'interroger, faisant passer les espaces de la ville et en particulier les espaces autoconstruits et non planifiés au tamis de ceux-ci. Et, ce n'est peut-être pas si étrange que nous ayons retrouvé dans le tissu des bidonvilles une part du tissu ancien de la Casbah que l'armée française (ses ingénieurs du génie, ses architectes, cartographes et urbanistes) détruisit. En particulier, cette lente progression de ce que nous appelons « espace public » à ce, qu'encore, nous appelons « espace privé ». À lire ainsi le bidonville réapparaissaient les derb, znirha et autres... expressions qui ont, dans la culture du peuple, résisté à la colonisation de l'espace et de l'esprit.
Il convient de poursuivre la décolonisation de la langue comme le préconisait Kateb Yacine pour entendre des réalités neuves et dépoussiérées de leur gangue de passé.
Khelwi
Terme dérivé du vocable « Khalwa » désignant la retraite des adeptes du soufisme (forme mystique de l'islam sunnite). également lié à « Khla » (le vide). Dans son sens profane, khelwi désigne un sentiment de bien-être et de plénitude passager, fréquemment associé au silence et à une sensation de complétude. Dans le langage commun, khelwi signifie aussi « super ! »
Fawdawi
Dérivé de l'expression « al bina al fadawi » utilisée dans l'administration algérienne pour désigner un habitat construit hors des normes légales et qui se traduit généralement par « habitat anarchique ». Cette expression sera reprise par les habitants de ces espaces pour s'autodésigner et revendiquer une place dans la ville. Plus largement, fawdawi désigne le désordre, le chaos, l'anarchie, ou ce qui échappe au contrôle.
Hama
Notion désignant les relations sociales établies entre les habitants d'un même quartier et, par extension, les différents quartiers de la ville. La hawma est un espace protégé, mais sous contrôle, régi par un code de comportements spécifiques. Espace dont les limites géographiques sont mouvantes, souvent tourné vers d'une mosquée et d'une école, mais principalement incarné par les individus qui le composent.
Derb
Sorte d'impasse, unité fondamentale du voisinage protégée et « intimisée » par des décrochements et des angles morts. Le derb s'intégrait à l'unité spatiale plus vaste, qu'est la hawma.
Anika
Impasse, plus intime que la précédente, commune à quelques familles seulement. L'unité spatiale se resserre aussi autour d'un espace que nous pourrions appelé semi-privé.
Houma
Concept exprimant le distingo entre ce qui appartient au même groupe et ce qui est situé hors de ses limites. Désigne l'endehors et communément, « les autres », se traduisant par « eux ».
Orma
Notion d'intimité et de territoire privé, s'appliquant par extension à l'espace du dedans, de la vie intérieure et de l'intime. BIDONVILLE LEÇON ALGéROISE #5 : LE DEVENIR VILLE DU BIDONVILLE LA CASBAH D'ALGER : UN BIDONVILLE CLASSé À L'UNESCO
Pour qui a rêvé « Alger la blanche » sur les chansons de Lili Boniche, il peut être déroutant à la visite de la Casbah et de ses abords de découvrir des toits-terrasses « squattés » de tentes et de paraboles, d'hasardeux agrandissements en matériaux contemporains et synthétiques, ou de voir des piliers ottomans et leurs pleins cintres « zigouillés » au profit de quelques poutres métalliques libérant l'espace au sol pour y garer davantage de voitures ou simplifier le stockage.
C'est oublier qu'on y vit à 50 000 ; qu'à la Casbah, les pauvres ont encore droit de cité. Et que la Casbah, loin d'être figée dans un passé vertueux, évolue et continue d'accueillir de nouveaux habitants même si, « pour y dormir, faut se pousser » et faire de la place au milieu des divers palais, hammams, mosquées et souks, dont la forme urbaine représente le témoignage d'une stratification de plusieurs tendances dans un système complexe et original qui s'est adapté, avec une remarquable souplesse, à un site fortement accidenté.
En décembre 2013 on célébrait le 21e anniversaire du classement de la Casbah d'Alger, dans la liste du patrimoine mondial de l'Unesco qui identifie des menaces à l'intégrité du site liées à là « sur-densification » et à des « interventions non contrôlées ». D'autres risques proviennent des séismes et des incendies, ainsi que des glissements de terrain et des inondations.
C'est alors cette dimension immatérielle de l'accueil, imprimant parfois au visage de la Casbah les stigmates du bidonville, que mettent en danger les différents projets de réhabilitation et le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé (PPSMVSS), codifié par le décret exécutif n° 324-2003 et encore en préparation.
Désormais classées, les pierres de la Casbah doivent être conservées, restaurées. Reste à définir les moyens d'y parvenir. Restauration de ce qui peut l'être ? Reconstitution à l'identique de ce qui manquerait au tableau original ? Les différentes écoles du « bien restauré » ont de quoi s'affronter. Le modèle espagnol préconise, à l'instar de la réhabilitation (réputée réussie) de la Medina de Tolède, de conserver de la Casbah ce qui peut l'être, mais surtout d'assumer nos incapacités, y compris techniques, à restaurer certains bâtiments sans les dénaturer profondément. Ainsi, on préférera parfois la destruction à un « acharnement patrimonialistique », transformant leur emprise au sol en espace public, places, jardins, belvédères. La réhabilitation devient l'occasion d'aérer en quelque sorte le tissu. Une partie du patrimoine bâti étant confié aux soins de propriétaires privés disposant de l'envie et des ressources pour restaurer (dans les règles) et entretenir les abords des bâtiments.
Cette solution a pour elle le bon sens et la compréhension d'un quartier et de ses acteurs comme une sorte d'écosystème. Elle implique cependant d'évincer l'écosystème existant, incapable d'oeuvrer à la patrimonialisation (en l'espèce, les habitants pauvres) au profit d'un autre possédant moyens et culture. Elle implique d'autre part une transformation radicale du tissu et, par là, de ce qui a malgré tout résisté au temps et aux multiples interventions urbaines, c'est à dire ce complexe dialogue entre (les mots précis manquent à la langue française) espace public et espace privé. Exit donc « derb », « znirha », etc. composantes d'un système spatial encore opérant. La patrimonialisation du bâti préconisée dé-patrimonialise l'urbanité présente. Exit aussi, les tentes sur les toits, les agrandissements nécessaires à l'activité ou la famille. Exit en somme une valeur patrimoniale immatérielle de la Casbah : l'accueil ! C'est ailleurs que cette dimension, inconsidérée par le plan de sauvegarde, se réorganise recomposant, l'urbanité de la Casbah dans les bidonvilles d'Alger. LEÇON STéPHANAISE #1 : LORSQUE L'EXISTANT NE SE VOIT PAS
Derrière le mur peinturluré de la bretelle d'autoroute reliant Rouen au reste du monde, au pied d'une centrale électrique se trouvent des baraques en dur ou presque, construites de 1950 à aujourd'hui, entre les pylônes des lignes à haute tension. Portes, fenêtres à double vitrage, boîtes aux lettres, balançoire dans le jardin, au fil du temps, 28 petits pavillons se sont consolidés et sont devenus lieux de vie - et pour certains, de travail - de nombreuses familles.
Jean, 43 ans, vit dans cette rue depuis 16 ans.
« À l'époque, j'ai acheté ça une bouchée de pain, c'était une ruine quand je suis arrivé, mais avec tous les travaux que j'ai faits dedans, elle vaudrait 30 000 euros maintenant. » Surpris de me croiser dans cette rue où personne ne passe, il m'invite à boire un café dans cette maison où il vit seul et qu'il est fier d'avoir entièrement refaite à neuf, de la plomberie de la salle de bain aux fenêtres à double vitrage qui le protègent du bruit incessant des voitures qui s'engagent sur l'A13 et que le mur dressé là - pour les soustraire au bruit autant qu'aux regards - ne suffit pas à atténuer. Il voudrait refaire sa façade, mais sa priorité est avant tout d'acheter une voiture pour aller travailler comme menuisier avec ses frères, qui vivent dans la même rue. Et pour aller à Darnétal, au pôle emploi où il ne peut plus se rendre en bus depuis que les bureaux ont été déplacés.
S'il loue le terrain comme parcelle-potager 500€ par an, sa maison en revanche est à lui depuis qu'il l'a achetée à celui qui l'avait construite et y vivait avant lui. Officellement il n'est pourtant ni locataire, puisqu'il ne peut légalement vivre sur son terrain, ni propriétaire puisque cet habitat n'a pas le droit d'exister.
« On a essayé plusieurs fois. On a fait des pétitions. On est allé les voir pour avoir au moins une belle route, un peu de bitume, des lumières dans la rue, mais ils ne veulent pas, et le propriétaire s'y oppose aussi. » En cette absence de statut et d'une quelconque reconnaissance, malgré les requêtes des habitants et l'existence de ce quartier depuis plus de 60 ans, l'électricité reste le seul réseau auquel l'accès leur a été concédé.
« Mais c'est un quartier très tranquille ici, on y vit bien. »
Il connaît tout le monde. Depuis qu'il est là, presque personne n'est parti ni arrivé. Un certain esprit de « communauté » s'est installé. Lui est sicilien, né en France, il confirmera qu'encore aujourd'hui, beaucoup des habitants sont d'origine portugaise, arrivés au milieu du siècle dernier, à l'époque où la main-d'oeuvre étrangère était bienvenue dans les villes industrielles. Les enfants récupèrent la maison des parents ou en achètent une dans la rue, à un voisin.
« S'ils partent, ils doivent abandonner leur maison, et ça, personne ne le souhaite. Le propriétaire a donné un peu d'argent aux gens qui ont abandonné la maison au bout de la rue, mais vraiment rien »
Ces maisons n'ont d'existence que pour ceux qui les ont bâties, ou les habitent. Il n'existe pas de termes pour définir ces modes d'habiter, pour conférer un « statut » à ces habitants, le leur n'étant pour l'heure défini qu'en négatif : « sans droit ni titre. »
« Ce sont des maisons qui se sont construites comme ça. C'était des jardins et petit à petit ils ont construit des baraques et aujourd'hui des maisons. Enfin, ... ce sont des gens sans droit ni titre »
« Sans droit ni titre », au regard seulement de la notion de propriété privée. Qu'en est-il du droit de vivre, d'avoir un toit sur la tête, et même le luxe d'un petit jardin, d'un atelier ou d'un garage ? Qu'en est-il de ce droit d'être pris en considération par la commune dans laquelle on vit depuis 60 ans ? Du droit à habiter ?
Pour le PLU, ce quartier est « une sorte de lotissement défectueux », dont on n'est pas sûr de pouvoir affirmer qu'il s'agisse d'habitat. La solution proposée par les urbanistes en charge du dossier est si récurrente qu'elle surprend à peine : expulser les occupants « sans droit ni titre », donc sans difficulté ni scrupule, faire place nette et faire intervenir un aménageur - aujourd'hui seul maître habilité à faire de la ville. Ce dernier pourra construire et vendre en lieu et place de ce quartier d'habitation, un autre quartier d'habitation, le bon cette fois, beau et homogène, pour accueillir un jeune couple de cadres embauchés dans une des entreprises du technopôle du Madrillet. Puisque finalement, pour poursuivre son rêve de Silicon Valley normande, la ville doit pouvoir loger ses ingénieurs.
D'autres espaces, présents mais invisibles aux yeux de la ville, ponctuent le territoire. Cet ancien coron ouvrier par exemple : la Cité Maurice Blot, à l'abandon depuis vingt ans. Les derniers habitants regardent partir à la dérive au large d'une ville qui était autrefois la leur, et dont l'état de délabrement est conditionné par cette peur du squat qui pousse le propriétaire a ôter portes et fenêtres aux maisons qui n'ont plus de forme qu'approximative.
De l'autre côté, à l'orée de la forêt, une autre rue - prolongée – à laquelle on n'a pas jugé utile de donner un nom, d'autres parcelles - potagers transformées spontanément en lieux de vie, des caravanes, des camping-cars aussi, sur un carré bitumé qui fait office d'aire d'accueil improvisée.
Si le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est moins bavard sur le devenir de ces habitats, on l'imagine tout de même mal intégrer l'actuel usage de ces terrains et leurs occupants à cette zone - « destinée à constituer le principal territoire de développement urbain de la commune à moyen et long termes. »
Si le PLU doit permettre, entre autres, aux villes de répondre par un urbanisme contrôlé aux « besoins émanant des situations locales », à quel chapitre des 129 pages de réglementation urbaine voit-on apparaître ces situations, aussi spontanées, précaires et informelles soient-elles, autrement que dans la perspective d'en faire table rase ? L'enjeu ne serait-il pas plutôt la recherche d'articulation de la ville officielle avec ces espaces qui ont déjà une vie, plutôt que de les raser en réponse à un insatiable besoin de logements neufs, de rues fraîchement bitumées, et de statistiques vantant la hausse du niveau de vie dans les quartiers « les plus défavorisés » ? Pourquoi ne pas admettre alors la spontanéité comme moyen juste, légitime et non violent de faire de la ville? CE N'EST PAS LE BIDONVILLE QUI INQUIÈTE LA RéPUBLIQUE, MAIS SA SOLUTION
Le 16 juillet 2013, à six heures, les habitants du bidonville du quartier de l'Eure ont été expulsés, en dépit des propositions d'accompagnement global des familles rroms, avancées par plusieurs associations travaillant avec les habitants, dont Echelle inconnue. Mardi 16 juillet 2013, ce que nous pensions pouvoir éviter est arrivé : célébration d'une nouvelle noce du bulldozer et de l'uniforme, siège du bidonville, « extraction » des familles, soit quatre-vingts personnes (dont 45 enfants) jetées encore un peu plus à la rue après le passage des bulldozers sur leurs habitations.
Pourtant, depuis plusieurs mois, à l'invitation du collectif de soutien, et des habitants eux-mêmes, nous travaillons avec les habitants du bidonville, réalisons, photos, vidéos, enregistrements. Outillons aussi le nomadisme que la République impose à ces populations en réalisant des équipements sanitaires nomades. Comme d'autres en France, nous nous attachons à aménager collectivement l'enfer.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2013, nous soumettions à la sous-préfecture du Havre un projet alternatif d'accompagnement des familles rroms vivant sur le bidonville du quartier de l'Eure ; projet plus économe en argent public que son simple anéantissement par bulldozers.
Le récépissé venait à peine d'être glissé sous notre porte que les uniformes se précipitaient pour ceinturer le bidonville situé à l'angle des rues du Général de La Salle et du général Hoche dans le quartier de l'Eure au Havre.
Ce projet soutenu par la Fondation Abbé Pierre et le Conseil Général, Cinecittà, la cité Rrom , prévoyait l'établissement d'un permis précaire d'un an (voir l'article consacré à Cinecittà p16). Un an, pour sortir du bidonville par le bidonville. Un an pour mettre en veille la politique de nomadisation forcée et pour mener à bien un projet cinématographique non pour les Rroms, mais avec eux, sans pour autant les cantonner au statut de figurants exotiques que l'industrie cinématographique semble leur réserver.
En collaboration avec le Conseil général qui devait, suite à notre interpellation, organiser une réunion avec les équipes chargées de l'accompagnement social, nous proposons de poursuivre le travail de « raccordement au monde » : rencontre avec les équipes de Médecins du Monde, prise de contact avec des entreprises privées locales, invention de solutions pour aménager cette urbanité née de la nécessité. La sous-préfecture, ce matin, a répondu : uniformes, siège et expulsion. Déjà au loin se font entendre les chenilles des bulldozers, ces nouveaux tanks de la petite guerre urbaine. Déjà, nous avions eu l'occasion d'entrevoir quelques-unes des solutions préfectorales : recensement des familles sur une table d'administration, rappelant sa sinistre ancêtre coloniale, avec l'aide d'un traducteur visiblement proche des services de police.
Quatre-vingts personnes, familles avec enfants se voyaient délivrer un simple papier écrit en romani les invitant à appeler le 115 !
Est-ce pur hasard que notre courrier semble croiser, si ce n'est déclencher, l'intervention policière ? Nous nous permettons d'en douter. La République a depuis longtemps choisi sa méthode, insensée : inquiéter, insécuriser et entretenir avec soin son syndrome de cécité volontaire.
À ce point qu'il est difficile de ne pas conclure que ce n'est pas tant le bidonville et son indignité qui effraient la République, mais la recherche de solution durable pour des populations, parmi les plus vulnérables, avec lesquelles il faut bien compter.
COÛT DE L'EXPULSION DU 16/07/2013 = 130 000 euros
nsensé d'une république qui a pourtant fait de la calculatrice le la de ses politiques. Trois mois après l'expulsion du Platz , le terrain est toujours là, vide. Un projet de caserne devrait voir le jour d'ici 5 à 10 ans. Ici, à la place des murs d'enceinte tombés, qui entouraient le Platz , ont poussé de grandes grilles vertes, laissant filtrer le regard et empêchant d'y adosser des cabanes. Comme précaution supplémentaire contre le risque que d'autres, motorisés cette fois, puissent un jour s'y installer, de grosses pierres noires ont été déposées tous les mètres, comme précaution supplémentaire. Expulser et maintenir un lieu vide de toute tentative de vie coûtent cher à nos institutions. L'expulsion du bidonville - Diagnostic social, ici réalisé par l'Association Française des Femmes en Difficulté et l'Armée du Salut. 15 000€
- Frais de justice (arrêté d'expulsion, recours, temps de travail des juges, avocats, etc.) ?
- Expulsion (présence de 50 CRS à 97 euros/jour et de camions, locations de pelleteuses à 870 euros/jour). 7 500€
- Nettoyage du terrain ?
- Propositions d'hébergement (20 places pendant 3 mois, ainsi que 20 repas par jour. Les 87 personnes du bidonville se sont relayées toutes les semaines) à l'Armée du Salut, pris en charge par la DIHAL et la DDCS. 65 000€
Soit 97 500€
Maintenir le terrain vierge de toute intrusion :
- Démolition de 280 mètres linéaires de mur en béton (hauteur 2,00 m) à 30 euros/m2, et la mise en benne. 18 800 €
- Pose de 230 mètres linéaires de grille verte (hauteur 2,00m), c'est-à-dire 90 plaques à 60 euros l'une. 5 400 €
- Pose d'environ 70 pierres d'une tonne chacune (100 euros la tonne). 7 000 €
Soit 31 200€
Sommaire du numéro 5
--------------------
ET SI PARIS FAISAIT SEMBLANT DE NE PAS VOIR SON FONCIER?--------------------
HABITER COMME CONTESTER
LA ROUTE VERSUS LE MUR
L'HABITAT MOBILE OUVRIER DE DIEPPE À MOSCOU
L'HABITER MOBILE OU L'ALTERMÉTROPOLISATION
L'HYPOTHÈSE DE L'HISTOIRE
MOSCOU : DÉRIVE EN TERRITOIRE MIGRANT
ON VA LÀ OÙ IL Y A DU TRAVAIL !
SAVOIR MAISON GARDER : UNE VILLA MOBILE RECOMPOSABLE
EDITO / JOURNAL À TITRE PROVISOIRE N°5 : MAKHNOVTCHINA / ENTRE CIRCULATION ET SÉDENTARISATION : HABITER L'IMMOBILIER
NOIRE LA RUBRIQUE : SUR LA ROUTE!
BIDONVILLE DE QUI ES-TU LE PROBLÈME ? DE QUOI ES-TU LA SOLUTION ?
TU VEUX QU'ON BOUGE ? OK ! MAIS COMME ON NE DÉMÉNAGE PAS D'UN BIDONVILLE